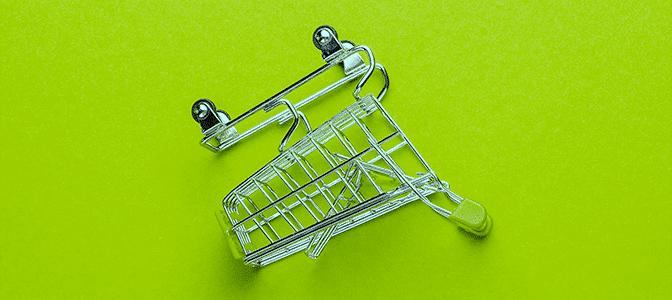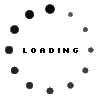Or donc Bernie Sanders a renoncé. Avant d’en venir à ce triste événement, un petit retour en arrière s’impose.
Le système politique américain est fort différent de ce que l’on connaît en Europe occidentale continentale, tant pour des raisons sociologiques et culturelles que de technique électorale. Il n’est guère étonnant dans ce contexte que, depuis la fin de la Première guerre environ, les joutes électorales se sont déroulées sur un terrain très étriqué.
Le système électoral, assez semblable au système britannique, est basé sur le scrutin uninominal à un tour, avec une sorte d’exception pour l’élection présidentielle et ses « primaires ». Il se caractérise aussi par l’absence concrète de membres, comme nous les connaissons, de partis politiques. Sont considérés comme membres des « partis politiques » ceux qui en font la déclaration publique (!) aux instances officielles de leur État. Ça a été longtemps un critère de sélection pour la participation aux « primaires ».
Il n’y a pas de « partis politiques » avec un programme émanant du choix de ses militants. Les « partis » dominants sont donc plus des associations de circonstance que des organisations orientées idéologiquement et tendant à la mise en œuvre de mesures marquées dans les domaines sociaux, économiques ou sociétaux.
Il ne reste pratiquement que deux «partis» dans ce contexte car les scrutins uninominaux ne font subsister que des choix binaires, où les électeurs se positionnent souvent au final plutôt contre le candidat de l’autre camp que pour « leur » candidat. Et pour espérer gagner, la tradition électorale américaine a longtemps limité les candidats d’un camp à tenter de gagner des électeurs du camp adverse, et vice-versa. Le résultat est une course exacerbée au centrisme, et l’émergence dans le discours des médias du terme « modéré » (repris platement par les médias européens) désignant ceux qui ne s’écartent pas trop de cette voie centriste.
Jusqu’en 2016, on a pu observer un conformisme absolu à cet extrême centrisme : la succession de présidents comme Truman, Eisenhower et Kennedy (pour ne pas entrer dans des querelles quant à des mandats plus récents) l’illustre parfaitement : il est difficile de déterminer là-dedans qui a été plus ou moins progressiste ou réactionnaire. Plus récemment, les positions prises par Obama montrent à suffisance cette adhésion aveugle au centrisme, non seulement pour se faire élire mais même pour gouverner, où son attachement aux solutions dites bipartisanes ne l’ont mené à pratiquement aucun résultat durant les deux premières années de ses mandats, les deux seules où il aurait pu faire aboutir quelque chose puisque les six autres ont été paralysées par la «cohabitation» avec un Congrès hostile.
La perte progressive d’influence effective du gouvernement américain par rapport aux grandes forces économiques, voulue en connaissance de cause par la plupart des élus américains, a conduit à un renversement de l’attitude d’une partie de l’électorat américain. Reléguées socialement et économiquement par les effets de la mondialisation de l’économie, les victimes du libre-échange ont cessé de croire aux discours lénifiants du centrisme.
C’est à ce moment, en 2016, qu’ont émergé les candidatures, hors parti, de deux personnages dont les discours, aux antipodes l’un de l’autre, sont radicalement sortis du cadre.
Bernie Sanders est le seul sénateur qui ne se présente ni comme Démocrate ni comme Républicain, mais comme indépendant, ou parfois socialiste. Même s’il s’est retrouvé à voter comme ses collègues Démocrates sur 98% des points votés au Sénat, il a toujours gardé ses distances avec une organisation dont il a bien perçu non seulement la faiblesse idéologique mais aussi le rôle néfaste dans la perception de la politique dans certaines couches de la population, dont très clairement la plus jeune. Bernie s’est engagé depuis toujours comme socialiste ou social-démocrate ce qui peut sembler fort peu révolutionnaire vu depuis certains continents, mais qui l’est de fait dans le contexte américain.
Bernie défend entre autres l’assurance-maladie universelle, le salaire minimum à 15 $/h, la gratuité des études supérieures dans les établissements publics, la réduction de la dette colossale des étudiants, l’exclusion des lobbies du financement des campagnes électorales, la réforme en profondeur des traités de libre-échange, la taxation des hauts revenus, l’introduction de congés parentaux et de maladie, de vrais congés payés, la prise en compte sérieuse des changements climatiques, le traitement humain des demandeurs d’asile latino-américains et, en politique extérieure, la fin du soutien inconditionnel des États-Unis à Israël contre les Palestiniens et la fin de la guerre menée au Yémen par les alliés des Américains dans la Péninsule arabique.
C’est cet engagement idéologique clair qui l’a fait émerger dès les primaires de 2016. Pourtant il n’est pas parvenu à s’imposer lors de ce premier engagement. Ici il faut comprendre les mécanismes qui sous-tendent les choix «politiques» d’une population, par construction, très peu politisée : l’absence de réflexion personnelle est suppléée par un rôle particulièrement fort des médias (presse écrite, télévision et radio), et ce dans les deux clans qui se disputent le pouvoir.
En 2016 comme en 2020, Bernie n’a obtenu le soutien d’aucun média largement écouté ou lu : il est de tradition que la presse, même la grande dite sérieuse, exprime son choix ; le New York Times comme le Washington Post, toujours influents dans les milieux dits «libéraux» ont pris fait et cause contre Bernie.
Aux antipodes de Bernie, 2016 a vu débarquer Donald Trump, dont le discours simpliste et outrancier a balayé le paysage dans le camp des Républicains. Ce dynamitage a eu des répercussions toujours sensibles aujourd’hui. Le discours extrême-centriste est devenu inaudible dans de larges couches de la population, en particulier chez les victimes de la politique économique libre-échangiste prônée par le gouvernement Obama ; son ancienne ministre Hillary Clinton, classée avec raison parmi les promoteurs de cette politique et donc préférée des milieux extrêmes-centristes qui ont favorisé sa désignation à l’issue des primaires chez les Démocrates en 2016, en a fait les frais (malgré sa légère victoire aux suffrages populaires, ignorés dans ce système électoral archaïque). Elle avait non seulement battu l’épouvantail Sanders mais aussi l’inconsistant Joe Biden, mais s’est inclinée devant le bulldozer Trump.
En 2020, avec néanmoins quelques variations positives, on a rejoué la même mauvaise pièce. Les « caciques » (à défaut de dirigeants) du camp des Démocrates, dont Obama et surtout Hillary Clinton, ont attaqué Bernie, comme la belle presse « libérale ». Malgré des avances remarquables chez les jeunes (mais dont trop peu s’abaissent à voter) et dans la population dite hispanique, cela n’a pas suffi. Égarée dans le souvenir de leur premier président de couleur, la population dite afro-américaine a été convaincue de se prononcer pour son ancien vice-président, dont on serait bien en peine de se souvenir d’une action positive en sa faveur, et bien au contraire si on va fouiller dans les poubelles de sa carrière. Les Démocrates plus âgés, figés dans leurs anciens réflexes, se sont comportés comme à leur ancienne et mauvaise habitude de faire confiance à un «modéré».
Il faut encore souligner le rôle médiocre d’Elizabeth Warren dans cette affaire. Elle qui se retrouvait avec Bernie sur certains points de programme réellement progressistes comme l’assurance-maladie universelle, a fait totalement défection dès qu’il est apparu qu’elle était hors course. Dans le nouveau paysage politique américain, son discours n’avait plus de place. S’exprimant comme si rien n’avait changé, sa mollesse la condamnait ; si on veut faire avancer des idées non-centristes, il faut désormais les exprimer clairement et plus comme une «modérée». Son refus de soutenir Bernie après sa propre éviction en dit long sur la force de ses convictions.
On peut évidemment se réjouir que l’engouement populaire inédit pour la candidature de Bernie laissera des traces positives pour l’avenir. En particulier le soutien de jeunes figures remarquables comme Alexandria Ocasio-Cortez et Rashida Tlaib, et aussi Pramila Jayapal, est de bon augure. Bernie a bénéficié du soutien inconditionnel des Democratic Socialists of America, le PS de gauche américain, lui-même faisant partie de la plate-forme Our Revolution lancée par Bernie. Les DSA pourraient être le noyau d’une organisation susceptible de briser le bipartisme; mais il est encore bien tôt pour l’affirmer. Ce qui est en revanche sûr, c’est qu’à court terme les perspectives sont sinistres.
Le débat va donc se dérouler à l’automne, et avant, entre un Trump, que rien n’empêche de dire n’importe quoi avec d’autant plus de force que cela n’a aucun sens, et le mollasson Joe Biden, exemple-type de ce qu’était le débat politique américain avant 2016, incapable de formuler une idée originale, incapable de sortir une phrase convaincante. À moins d’un événement exceptionnel, rien ne pourra plus empêcher le renouvellement du mandat d’un déséquilibré, xénophobe, ultra-réactionnaire, incontrôlable à la tête d’une des principales puissances mondiales.
Une opinion de Thierry Bingen
Source illustration : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders#/media/Fichier:Bernie_Sanders_July_2021.jpg